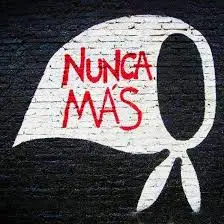Juan Carlos Cobián Letra: Enrique Cadícamo
Shusheta ou sa variante shushetín désigne un dandy, un jeune homme élégant, avec une nuance qui peut aussi qualifier un mouchard. Les Dictateurs de la Décennie infâme ne s’y sont pas trompés et l’histoire des paroles en témoigne. Ce portrait de ce shusheta, peint crûment par Cadícamo sur la musique de Cobián n’est pas si flatteur.
Extrait musical

Paroles usuelles (1938)
Le tango a été écrit en 1920 et était donc instrumental, jusqu’à ce que Cadícamo accède à la demande de son ami de lui écrire des paroles pour ce titre. Il le fit en 1934, mais la version habituelle est celle déposée à la SADAIC en 1938.
Toda la calle Florida lo vio
con sus polainas, galera y bastón…Dicen que fue, allá por su juventud,
un gran Don Juan del Buenos Aires de ayer.
Engalanó la puerta (las fiestas) del Jockey Club
y en el ojal siempre llevaba un clavel.Toda la calle Florida lo vio
con sus polainas, chambergo (galera) y bastón.Apellido distinguido,
gran señor en las reuniones,
por las damas suspiraba
y conquistaba
sus corazones.
Y en las tardes de Palermo
en su coche se paseaba
y en procura de un encuentro
iba el porteño
conquistador.Ah, tiempos del Petit Salón…
Cuánta locura juvenil…
Ah, tiempo de la
sección Champán Tango
del “Armenonville”.Todo pasó como un fugaz
instante lleno de emoción…
Hoy sólo quedan
recuerdos de tu corazón…Toda la calle Florida lo vio
con sus polainas, galera y bastón.
Juan Carlos Cobián Letra: Enrique Cadícamo
Vargas ne chante pas ce qui est en bleu. Cette partie des paroles est peut-être un peu plus faible et de toute façon, cela aurait été trop long pour un tango de danse.
En gras les mots chantés par Vargas à la place de ceux de Cadícamo.
Traduction libre des paroles usuelles et indications
Toute la rue Florida l’a vu avec ses guêtres, son chapeau et sa canne… (Polainas, c’est aussi contrariété, revers, déception, Galera, c’est aussi la prison ou la boîte à gâteau des fils de bonne famille. On peut donc avoir deux lectures des paroles, ce que confirme la version, originale, plus noire. Précisons toutefois que la partition déposée à la SADAIC indique chambergo, chapeau. Ce serait donc Vargas qui aurait adapté les paroles).
On dit qu’il était, dans sa jeunesse, un grand Don Juan du Buenos Aires d’antan.
Il décorait la porte (Vargas chante les fêtes) du Jockey Club et portait toujours un œillet à la boutonnière.
Toute la rue Florida l’a vu avec ses guêtres, son chapeau et sa canne.
Un nom de famille distingué, un grand seigneur dans les réunions, il soupirait pour les dames et conquérait leurs cœurs.
Et les après-midi de Palermo, il se promenait dans sa voiture à la recherche d’un rendez-vous, ainsi allait le porteño conquérant.
Ah, l’époque du Petit Salón… (Deux tangos s’appellent Petit Salón, dont un de Villodo [mort en 1919]. L’autre est de Vicente Demarco né en 1912 et qui n’a sans doute pas connu le Petit Salón).
Combien de folie juvénile…
Ah, c’est l’heure du Tango Champagne de l’Armenonville.
Tout s’est passé comme un instant fugace et plein d’émotion…
Aujourd’hui, il ne reste que des souvenirs de ton cœur…
Toute la rue Florida l’a vu avec ses guêtres, son chapeau et sa canne
Premières paroles (1934)
Ces paroles n’ont semble-t-il jamais été éditées. Selon Juan Ángel Russo, Cadícamo les aurait écrites en 1934.
Cette version n’a été enregistrée que par Osvaldo Ribó accompagné à la guitare par Hugo Rivas.
On notera qu’elles mentionnent shusheta, ce que ne fait pas la version de 1938 :
Pobre shusheta, tu triunfo de ayer
hoy es la causa de tu padecer…
Te has apagao como se apaga un candil
y de shacao sólo te queda el perfil,
hoy la vejez el armazón te ha aflojao
y parecés un bandoneón desinflao.
Pobre shusheta, tu triunfo de ayer
hoy es la causa de tu padecer.Yo me acuerdo cuando entonces,
al influjo de tus guiyes,
te mimaban las minusas,
las más papusas
de Armenonville.
Con tu smoking reluciente
y tu pinta de alto rango,
eras rey bailando el tango
tenías patente de gigoló.Madam Giorget te supo dar
su gran amor de gigolet,
la Ñata Inés te hizo soñar…
¡y te empeñó la vuaturé !
Y te acordás cuando a Renée
le regalaste un reló
y al otro día
la fulería
se paró.
Juan Carlos Cobián Letra: Enrique Cadícamo
Traduction libre de la première version de 1934
Pauvre shusheta (un shusheta est un jeune vêtu à la mode en lunfardo, voire un “petit maître”), ton triomphe d’hier est aujourd’hui la cause de tes souffrances…
Tu t’es éteint comme s’éteint une chandelle et de shacao (je n’ai pas trouvé la référence) il ne te reste que le profil, aujourd’hui la vieillesse t’a relâché le squelette et tu ressembles à un bandonéon dégonflé.
Pauvre shusheta, ton triomphe d’hier est aujourd’hui la cause de ta souffrance.
Je me souviens qu’alors, sous l’influence de tes guiyes (gilles, copains ?), tu étais choyé par les minusas (les filles), les plus papusas (poupées, filles) d’Armenonville.
Avec ton smoking brillant et ton look de haut rang, tu étais le roi en dansant le tango, tu tenais un brevet de gigolo.
Madame Giorget a su vous donner son grand amour de gigolette, Ñata Inés vous a fait rêver… (le salon de Ñata Inés était un établissement de Santiago, au Chili, apprécié par Pablo Neruda) et a mis ta décapotable (vuaturé est une voiture avec capote rabattable à deux portes. Prononciation à la française.) en gage !
Et tu te souviens quand tu as offert une montre à Renée (sans doute une Française…) et que le lendemain les choses se sont arrêtées.

D’Agostino et la censure
Vous l’aurez compris, le terme Shusheta qui peut qualifier un « mouchard » a fait que le tango a été censuré et qu’il a dû changer de nom.
En effet, pour éviter la censure, D’Agostino a demandé à Cadícamo une version expurgée que je vous propose ci-dessous.
On notera toutefois que la version chantée en 1945 par Vargas prend les paroles habituelles, celles de 1938, mais débarrassée du titre polémique au profit du plus neutre El aristócrata. C’est la raison pour laquelle, les versions d’avant 1944 (la censure a commencé à s’exercer en 1943) s’appellent Shusheta et les postérieures El aristócrata. Aujourd’hui, on donne souvent les deux titres, ensemble ou indifféremment. On trouve aussi parfois El elegante.
Paroles de El aristócrata, version validée par la censure en 1944
Toda la calle Florida te vio
con tus polainas, galera y bastón.Hoy quien te ve…
en falsa escuadra y chacao,
tomando sol con un nietito a tu lao.
Vos, que una vez rompiste un cabaré,
hoy, retirao… ni amor, ni guerra querés.Toda la calle Florida te vio
con tus polainas, galera y bastón.Te apodaban el shusheta
por lo bien que te vestías.
Peleador y calavera
a tu manera te divertías…
Y hecho un dandy, medio en copas,
en los altos del Casino
la patota te aclamaba
sí milongueabas un buen gotán.Ah, tiempo del Petit Salón,
cuánta locura juvenil…
Ah, tiempo aquel de la Sección
Champán-Tango de Armenonvil.
Todo pasó como un fugaz
instante lleno de emoción.
Hoy solo quedan
recuerdos en tu corazón.Toda la calle Florida te vio
con tus polainas, galera y bastón.
Traduction libre de la version de 1944
Toute la rue Florida t’a vu avec tes guêtres, ton chapeau et ta canne.
Aujourd’hui, qui te voit…
Avec une pochette factice et chacao (???), prenant le soleil avec un petit-fils à tes côtés.
Toi, qui as autrefois dévasté un cabaret, tu prends aujourd’hui ta retraite… Tu ne veux ni amour ni guerre.
Toute la rue Florida t’a vu avec tes guêtres, ton chapeau et ta canne.
On te surnommait le shusheta à cause de la façon dont tu t’habillais.
Bagarreur et crâneur, à ta manière, tu t’es amusé…
Et fait un dandy, les coupes à moitié bues, depuis les hauteurs (galeries) du Casino, la bande t’encouragerait si tu milonguéais un bon gotan (Tango en verlan).
Ah, cette époque du Petit Salon, que de folie juvénile…
Ah, cette époque de la section Champagne-Tango de l’Armenonville.
Tout est passé comme un instant fugace et plein d’émotion.
Aujourd’hui, il ne reste que des souvenirs dans ton cœur.
Toute la rue Florida t’a vu avec tes guêtres, ton chapeau et ta canne.
Autres versions
Le premier enregistrement, par le compositeur, Juan Carlos Cobián. C’est bien sûr une version instrumentale, puisque les paroles n’ont été écrites que onze ans plus tard.
Cette version, sans doute la plus connue, utilise les paroles non censurées de 1938. Le titre a été modifié pour éviter la censure. Il est vrai qu’en dehors de Shusheta qui pouvait irriter un censeur très suspicieux, le texte n’était pas si subversif. J’imagine que D’Agostino qui avait envie d’enregistrer le titre avec Vargas a demandé les paroles censurées, puis y a renoncé, peut-être en ayant acquis la certitude que la censure n’interdirait pas ce titre. Vargas a apporté de très légères modifications au texte, mais sans que cela soit pour des raisons de censure, ces modifications étant anodines.
Une version étonnante, pour l’auditeur, mais encore plus pour le danseur qui pourrait bien se venger d’un DJ qui la diffuserait en milonga. Je n’ai pas dit qu’il fallait jeter cet enregistrement, juste le réserver pour l’écoute.
L’ancien complice de D’Arienzo a ses débuts et de nouveau, quand il a remplacé Biaggi qui venait de se faire virer, propose une version nerveuse et ma foi sympathique de Shusheta. La rythmique pourrait déconcentrer des danseurs très habitués à d’autres versions, mais on peut s’amuser, lorsque l’on connaît un peu le titre avec les facéties de Polito au piano. On se souvient que quand il avait remplacé Biagi, il avait continué les fioritures de son prédécesseur. Là, ces ornementations sont bien personnelles et ne doivent rien à Biagi.
Vargas fait cavalier seul, sans D’Agostino. Je vous conseille de vous souvenir plutôt de la version de 1945.
Une version destinée à l’écoute, au concert.
Je vous propose d’arrêter là, il existe bien d’autres versions, mais rien qui puisse faire oublier les merveilleuses versions de D’Agostino et Vargas et celle de Di Sarli.